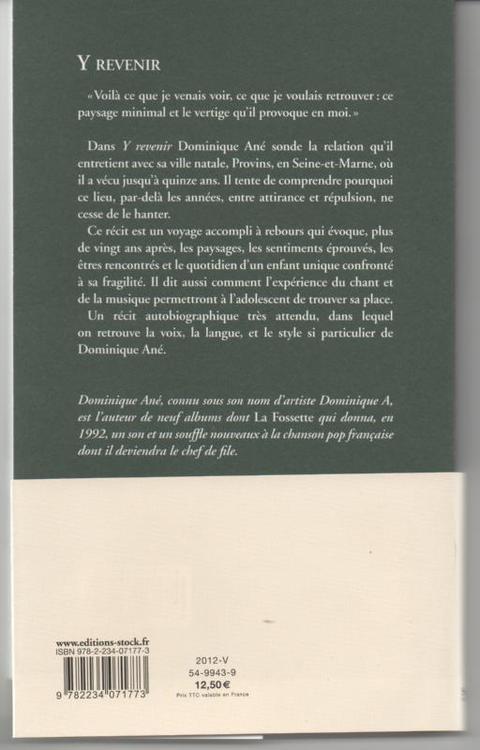Je viens de profiter d’une de ces douce soirée d’été ou le planning se calme un peu pour me plonger dans le livre de Dominique A. Chanteur que j’adule depuis toujours.
Il nous propose aujourd’hui son second livre « Y revenir » après avoir sorti en 2008 « Un bon chanteur mort » qui était plus une explication de la naissance d’une chanson qu’un œuvre de fiction.
Aujourd’hui a l’occasion d’un retour dans sa ville d’enfance Provins (Seine et Marne) pour un concert il nous raconte ses souvenirs.
Bien entendu ce livre m’a ravi il est peut être un peu long à se mettre en route mais des que l’adolescence et là, tout s’accélère, il se permet enfin de nous parler de sa fragilité et de son amour pour la musique. J’ai par moment eu l’impression que Dominique A racontait ma vie, tant mon amour pour ma ville et aussi pour la musique sont grands, je pense que comme lui, si j’aime tant la musique c’est aussi pour me refugier me couper du monde.
Si j’avais un tant soit peu de talent c’est un livre que j’aurais rêver d’écrire ou s’entremêle souvenirs, musique et psychologie. Comme moi il est attaché plus que de raison aux murs de son enfance, comme moi il se cache derrière une carapace comme moi le temps qui passe le change. Même les détails comme détester les leçons de la natation a l’école qu’il ose même comparer au service militaire pourraient être miens. « je vois se profiler le service militaire comme une séance de natation en continu » . Bref ce livre est miroir
J’ai dévoré ce livre d’une traite, il nous permet de mieux connaitre ce chanteur que l’on pense aujourd’hui fort mais ce sont ces figures intimes qui ont bouleversé a tout jamais une chanson française trop tranquille
Simon Pégurier
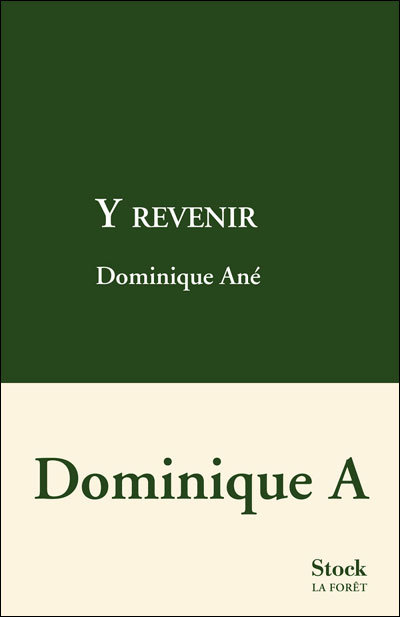
Je vous propose ci dessous un extrait : qui résume bien je pense le livre où se mêlent, les souvenirs, la cruauté des Hommes, la naissance de l’amour pour la musique, l’aveu de ses propres faiblesses….
« La peur est mon pays. Peut-on l’écrire au titre du lieu de naissance sur la carte d’identité ? Ça me dédouanerait de mon incapacité à être courageux. J’envie ceux qui le sont. Mais la plupart le sont naturellement : leur courage n’est pas le fruit d’une lutte intérieure, il ne leur coûte rien. Je ne peux qu’avoir le cran d’accepter ma faiblesse, et d’en payer le prix, la peur, en espérant qu’elle suscite l’indulgence, et que les autres me laissent « passer »
Ce serait trop beau. S’il en est un qui ne me laisse pas passer, ce n’est pas un enfant, non mais mon instituteur. C’est un homme encore jeune, au visage avenant. Il me cite en exemple, parce que je suis appliqué, ce qui n’accroit pas ma popularité auprès des autres, qui me trouvent à part. Il aime sentir l’odeur de ma peur, et en partager le goût. Remarquant un jour que j’utilise mon index comme gomme, il brandit le cahier maculé de taches grisâtres, et prononce ce mot : « cochon ». La classe, électrisée s’en saisit, et se met à le chanter sur deux octaves, en marquant une césure nette entre le « co » et le « chon » : on dirait une sirène de pompier facétieuse. Le succès de cette distraction incite le Maître à la renouveler. Il me prend un jour à part pour savoir pourquoi je pleure lorsqu’on me traite de cochon.
Le bestiaire de l’angoisse ne s’arrête pas là. L’âne y talonne le cochon, et mon patronyme n’y est pour rien. Le Maïtre somme Eric Crétard de venir au tableau ; il le place sur l’estrade et dessine au-dessus de lui deux grandes oreilles. Les rires sont timides. Eric Crétard se tient droit, son visage n’exprime rien.
Le Maître tombe malade. Une jeune femme le remplace et nous apprend des chansons. Elle repère mon timbre de voix, et me confie les couplets. Pour une fois, être remarqué ne me pèse pas. J’aime chanter, et je n’ai pas de problème à le faire en public, pas encore. Mon assurance inhabituelle intimide mes camarades. Lorsque je chante, tout est simple, les autres se taisent, et baissent la tête.
Depuis ma chambre, j’entends une musique monter du salon. Au bas de l’escalier, un vinyle tourne. J’observe l’aiguille creuser les sillons, comme appuyant sur un point de douleur qui fait s’élever une voix plaintive. Celle-ci évoque la mort d’un amour, dans un pays lointain. La tristesse de ce chant ne me rebute pas : au contraire, elle m’ôte à la mienne son caractère exclusif. M’immerger en elle me raccroche hors de chez moi.
Les mots que porte cette voix en appellent d’autres tapis en moi. J’ouvre des cahiers où ils se répandent bientôt.
C’Est un apaisement, une consolation, immédiate, et renouvelable à l’envi. Le silence, qui semble prendre possession de tout ici, recule.
A l’école, l’étau se desserre : je passe dans la classe du directeur, dont l’humeur égale ne se prête à aucun débordement. Les lieux sont moins austères, les murs plus clairs, la lumière du jour y entre volontiers. Après la cantine, nous regardons des programmes éducatifs sur une télévision fixée en hauteur. Sa présence fait le lien avec la vie à la maison, mais ici, les images sont comme dépossédées de leur pouvoir de nuisance. Des tortues géantes avancent sur des galets, des coulées de lave rampent sur un volcan, des scientifiques collectent des ossements. Je n’en retire rien, sinon le plaisir de voir les images défiler, et d’éprouver qu’à l’école l’extérieur peut s’immiscer.